
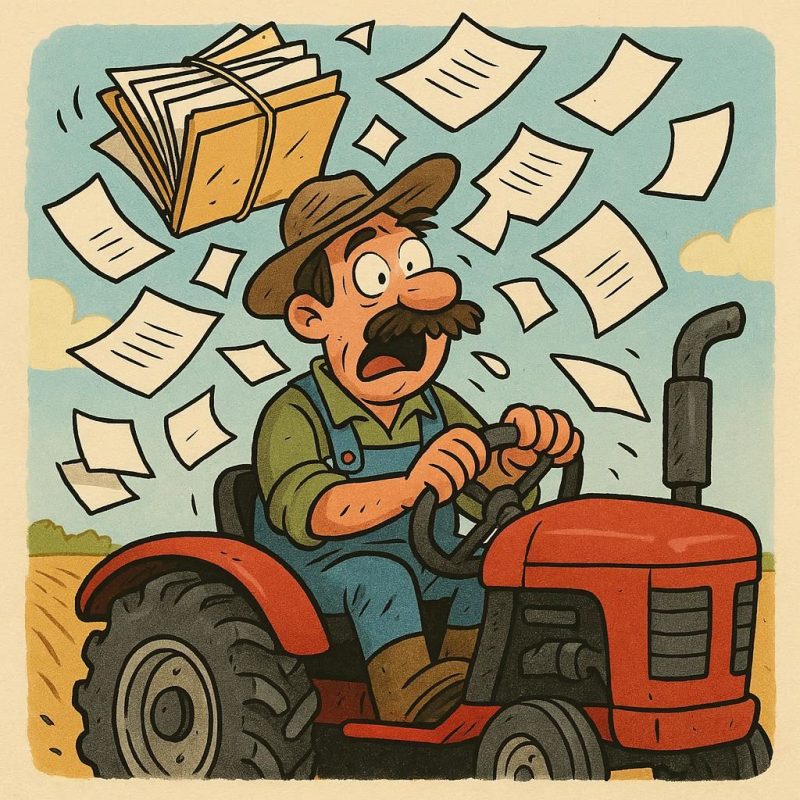
Les normes, ennemies des agriculteurs ?
La production agricole est de plus en plus encadrée par des normes. D’un point de vue économique, les normes portant sur le bien-être animal ne menacent pas nécessairement la pérennité des élevages, mais elles peuvent fragiliser la compétitivité européenne. Surtout si l’Union européenne n’impose pas le principe de réciprocité avec les produits importés.
Le parcours législatif de la loi Duplomb a été émaillé de nombreuses controverses. Cette loi a cristallisé une opposition maintenant ancienne entre d’un côté une partie du monde agricole qui estime que l’agriculture française étouffe sous diverses contraintes ; et de l’autre une partie de la société française qui estime que l’agriculture pollue, est nocive pour la santé, maltraite les animaux et doit donc être encore plus encadrée.
L’objet de cet article est de se pencher sur une petite partie de ce vaste sujet : l’évolution de certaines réglementations et leurs conséquences pour l’agriculture, et ce d’un point de vue purement économique. Plus spécifiquement encore, nous allons nous interroger sur les effets économiques que peuvent avoir les évolutions des normes portant sur la façon de produire, en prenant l’exemple des normes sur le bien-être animal.
Un surcoût non négligeable
Toute nouvelle réglementation qui a pour objet l’amélioration du bien-être animal engendre nécessairement des surcoûts. Soit parce que cela nécessite des investissements pour les éleveurs, soit parce que cela entame une partie de la productivité, soit les deux. L’interprofession Anvol estime par exemple que le projet d’une nouvelle réglementation encadrant le transport des animaux génèrerait un surcoût de 526 millions d’euros pour la filière avicole française.
Cet article montre que plus le changement est important, plus le coût est élevé :
Pour cette raison, le monde agricole est souvent défavorable à des évolutions trop marquées, arguant que ce sont les agriculteurs et les acteurs de la filière qui en supporterait la charge financière. Et que cela les mettrait donc en péril. Est-ce que seules les filières auraient à en supporter les surcoûts ? Les choses sont plus compliquées…
Les marchés sont des systèmes dynamiques : le prix s’adapte en permanence à l’équilibre entre l’offre et la demande. Si les producteurs font face à des charges supplémentaires et que les prix de vente ne sont pas ajustés en conséquence, l’offre baisse. Ce déséquilibre entraîne une remontée des prix qui s’ajustent pour couvrir au moins les coûts de production. A court terme, des risques de perturbation de marchés existent donc. Ils peuvent même pousser certains agriculteurs à arrêter. Mais la situation se rétablit par la suite.
Les consommateurs en payent le prix ?
Dans cette équation, l’inconnue est plus la consommation : est-ce que des normes élevées ne rendraient pas les produits animaux trop chers pour certains consommateurs ? Par exemple, si jamais demain la réglementation impose la norme ECC (European Chicken Commitment) en production de volaille, quels seraient les effets sur les volumes consommés alors que le coût de production est 37,5 % plus élevé qu’en standard ? (voir cette étude pour le détail)
Il est probable que cela engendrerait une baisse de la consommation et donc une baisse des volumes de production. Ce n’est cependant pas certain : ces quatre dernières années ont prouvé que de fortes hausses de prix en magasin n’ont eu que peu d’effet sur la consommation de viande.
Mais au final, les prix de vente s’adapteront afin de couvrir les surcoûts engendrés.
Gare à la concurrence
L’autre paramètre à prendre en compte est l’environnement concurrentiel. L’avantage d’une réglementation est qu’elle empêche toute distorsion de concurrence au sein de son espace d’application. Celle-ci étant décidée au niveau de l’Union européenne, tous les pays du marché commun sont logés à la même enseigne. C’est un des gros avantages par rapport aux initiatives nationales ou privées qui, si elles ne s’appuient pas sur des tendances de consommation solides, fragilisent les filières en les exposant à une concurrence moins chère. En outre, les réglementations permettent aussi d’anticiper les évolutions.
L’Union européenne est cependant aussi un marché en partie ouvert au commerce international. Toute nouvelle norme accroissant les coûts de production peut avoir des conséquences dans ce domaine. Pour les productions où l’UE est exportatrice nette, comme en porc, des surcoûts la fragiliseraient face aux concurrents américains ou brésiliens. Des normes de production exigeantes évinceraient donc l’UE de marchés internationaux où elle est déjà en peine face à des pays très compétitifs.
Dans le cas de figure où l’UE est importatrice nette, des normes plus sévères amplifieraient le sentiment d’injustice entre des exigences fortes pour les agriculteurs européens et en même temps l’importation de produits de pays tiers qui ne respectent pas ces exigences. « Pourquoi accepter de faire manger aux européens ce que les agriculteurs européens n’ont pas le droits de produire ? » Ce facteur est un point de tension fort qui peut créer des oppositions marquées à toute évolution législative. Accord avec le Mercosur, ouverture du marché avec l’Ukraine : la stratégie de l’UE dans ce domaine ne va pas vers la protection de son marché intérieur alors même que le protectionnisme prend de l’ampleur à travers le monde.
Des conséquences pas seulement économiques
Dans l’absolu, imposer des normes plus exigeantes ne remet pas en cause la pérennité des filières. Mais cela a des conséquences à trois niveaux :
- Agricole avec des changements de pratiques, des investissements nécessaires et une restructuration probable ;
- Social avec une alimentation plus chère pour les consommateurs ;
- Commercial avec une perte de compétitivité sur les marchés internationaux.
Le sujet est donc complexe d’autant que d’autres éléments que l’économie entrent en ligne de compte. Une partie de la société, difficilement quantifiable, soutient des normes plus strictes dans le domaine du bien-être animal mais aussi dans d’autres domaines (produits phytosanitaires etc.). Les nouvelles générations d’agriculteurs sont aussi plus sensibles à ces thématiques. Il est d’ailleurs probable qu’une grande majorité d’éleveurs actuels ont bien intégré les évolutions des normes passées et ne souhaitent pas revenir en arrière. Car souvent, elles s’accompagnent de meilleures conditions de travail.
Une autre considération porte sur les conséquences de l’invention de la viande cultivée. Si son développement est encore anecdotique, le risque existe qu’elle fasse concurrence à terme à la viande traditionnelle. L’intérêt des éleveurs sera alors de s’en démarquer en montrant que leur activité respecte le vivant et est éloignée du paradigme industriel.
Rappel des principales réglementations européennes sur le bien-être animal spécifiques par espèce
| Espèce | Directive | Date d’application | Ce qui a changé |
| Veaux | 2008/119/CE | 1er janvier 2007 | Interdiction des cases individuelles pour les veaux de plus de 8 semaines. Obligation de l’élevage en groupe. |
| Poulets de chair | 2007/43/CE | 30 juin 2010 | Limitation de la densité d’élevage à un maximum de 33 kg/m² (avec dérogations sous conditions). |
| Poules pondeuses | 1999/74/CE | 1er janvier 2012 | Interdiction totale des cages conventionnelles. Obligation de cages aménagées ou de systèmes alternatifs. |
| Truies | 2008/120/CE | 1er janvier 2013 | Interdiction totale des stalles individuelles pour les truies gestantes. Obligation de l’élevage en groupe. |



