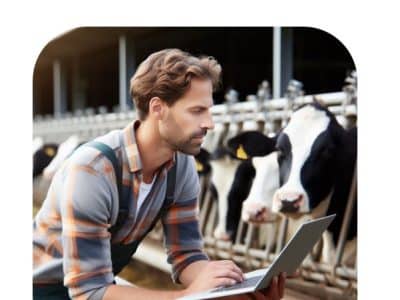

Les porteurs de projet en agriculture : une diversité de profils
Dans le cadre du projet Agrinovo, l’ESA d’Angers a mené un travail d’enquête quantitative sur les nouveaux agriculteurs. Quelles sont les trajectoires qui mènent à l’installation ? Quels sont les différents profils de ces nouveaux entrants ? Ce travail propose une typologie affinée des porteurs de projet et permet d’apporter des éclairages sur ces questions.
Si les profils des personnes qui s’installent évoluent, la perception et les pratiques agricoles se transforment aussi. Une grande enquête a été réalisée auprès d’agriculteurs récemment installés afin de caractériser la diversité de leurs profils et de leurs trajectoires. Plus de 3 400 agriculteurs installés en France en 2018 et en 2022 y ont répondu. L’enquête a permis de définir cinq profils-types, le cinquième pouvant lui-même se scinder en deux profils distincts.
Qui sont les agriculteurs et agricultrices nouvellement installé(e)s ?
Les héritiers bien préparés (34 % au total)
Ils ont une forte intégration dans le milieu agricole (parents agriculteurs, famille élargie agricole). Ils ont suivi une formation agricole et ont une expérience agricole diversifiée. C’est le profil classique de personnes qui reprennent l’exploitation familiale. Dans cette catégorie, les hommes sont surreprésentés (80 % contre 60 % dans la population globale) et ils sont plutôt jeunes (deux tiers ont moins de 30 ans).
Les héritiers sans vocation (22 %)
Eux ont aussi des parents agriculteurs ; en revanche, ils n’ont pas suivi de formation initiale agricole. Ils ont donc une moindre expérience professionnelle sur l’exploitation. Ils ont commencé leur carrière dans un autre secteur professionnel et ont ensuite opérés une reconversion en s’installant comme agriculteurs.
Les classes populaires rurales (16 %)
Non originaires du milieu agricole (NIMA à 97 %), ils sont plutôt issus des classes populaires (ouvriers, employés). Ils ont suivi une formation initiale agricole et vivaient déjà en zone rurale avant leur installation (90 %). Leur assimilation au milieu agricole n’est donc pas liée à leur famille mais à leur lieu de vie. Et c’est bien le fait de vivre en milieu rural qui leur a facilité l’accès à l’agriculture.
Les reconvertis des classes moyennes (20 %)
Comme le profil précédent, ce sont des personnes qui n’ont pas de parents agriculteurs (NIMA). Ils ont généralement eu des expériences professionnelles en dehors de l’agriculture avant de s’installer. Souvent d’origine urbaine, ils ont eu d’avantage que les autres profils, accès à leur terre grâce à des agences immobilières privées.
Les membres des classes supérieures urbaines (8 %)
Cette classe se distingue des « reconvertis des classes moyennes » car ils viennent de classes socio-professionnelles supérieures grâce à leurs parents et/ou leur formation et/ou leur métier antérieur. Ils ont donc un haut niveau de qualification (85 % ont un niveau Bac+5 et plus). Ces porteurs de projet sont très majoritairement d’origine urbaine et leur arrivée en en agriculture correspond à une reconversion. Ils peuvent être répartis en deux sous-classes :
- Les reconvertis (4,4 %) qui ne sont pas issus du milieu agricole.
- Les contre-mobiles qui sont des enfants d’agriculteurs (3,2 %), mais qui se distinguent des héritiers puisqu’après une carrière hors du secteur agricole, ils reviennent vers le métier de leurs parents.
Au travers des questions posées, ce travail s’intéresse également aux motivations de ces personnes à l’installation (reprendre l’exploitation, changer de métier, de milieu professionnel, travailler dehors, avec des animaux, mettre en œuvre ses valeurs, se sentir utile…), à leur vision du métier (je me considère comme un chef d’entreprise, un paysan, un innovateur…), à leurs pratiques professionnelles (mode de production, secteur de production, engagement professionnel…), ainsi qu’à leurs conditions d’exercice du métier (temps de travail, difficultés rencontrées…). Ces éléments montrent en quoi et comment les profils sont associés à des pratiques et des visions singulières du métier d’agriculteur.
Une plus grande diversité des profils de porteurs de projet
La typologie établie montre que les profils d’installations sont plus divers et contrastés que ne le laisse croire la simple distinction habituellement proposée entre les agriculteurs issus du milieu agricole (comme les héritiers et contre-mobiles) et ceux qui n’en sont pas issus (notamment les reconvertis).
Le profil des classes populaires rurales représente 16 % des enquêtés. Cette part est relativement conséquente. Or, ce n’est pas un profil qui est forcément bien identifié ou mis en avant dans les analyses habituelles.
En Bretagne, sur les 431 installations aidées (aide DJA) en 2024, 46 % sont réalisées hors du cadre familial (jusqu’au 3e degré inclus) et que 40 % sont des installations de personnes d’origine non agricole, sans que l’on puisse distinguer aisément les héritiers sans vocation ou les classes populaires rurales par exemple.
Dans l’étude de l’ESA d’Angers, la part importante (22 %) des héritiers sans vocation peut paraitre surprenante, mais elle s’explique par un effet démographique. A l’heure où un nombre massif d’agriculteurs atteignent aujourd’hui l’âge de la retraite, un grand nombre d’enfants qui avaient commencé leur carrière dans d’autres secteurs professionnels, reprennent finalement l’exploitation familiale.
Un besoin d’accompagnement adapté en fonction des profils
Avec l’enjeu majeur du renouvellement des agriculteurs, mieux connaitre la population agricole est essentiel. C’est un élément pour orienter les structures qui accompagnent les porteurs de projet dans leurs actions. Selon les profils, les besoins en accompagnement doivent être renforcés, pour certains, du côté de la formation, pour d’autres, du côté de la connaissance des réseaux agricoles, pour d’autres encore, du côté de la recherche de financement… Dans un contexte actuel particulièrement complexe et imprévisible, l’efficacité de cet accompagnement sera un facteur clé pour assurer la solidité et la résilience de nos agriculteurs.
Ce travail de recherche fondamentale menée par des sociologues de l’ESA d’Angers (laboratoire de recherches en sciences sociales (LARESS) de l’Ecole Supérieure des Agricultures) a bénéficié d’un financement du Ministère de l’agriculture et a été réalisé en partenariat avec Chambre d’Agriculture France.
Pour en savoir plus : la vidéo de l’atelier-conférence du 20 mars 2025



